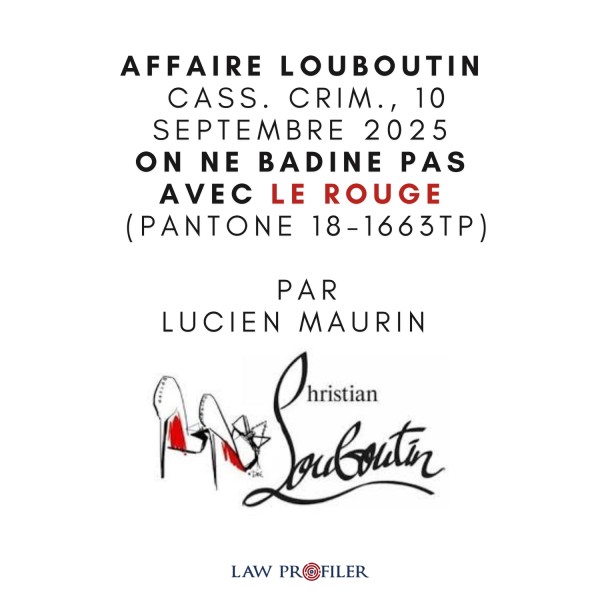
AFFAIRE LOUBOUTIN (Cass. crim., 10 septembre 2025) : on ne badine pas avec le rouge (Pantone 18-1663TP) par Lucien MAURIN
Par un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation pénale d’une société et de son gérant pour contrefaçon de la marque « semelle rouge » de Christian Louboutin et importation en contrebande de marchandises prohibées.
La Haute juridiction consacre la validité de cette marque dite « de position », reconnaissant à la couleur appliquée à un emplacement spécifique d’un produit un véritable pouvoir distinctif. Elle admet, en outre, la compatibilité du cumul des sanctions pénales et douanières avec le principe de proportionnalité, tout en cassant l’arrêt sur le seul volet civil, pour défaut de motivation du calcul du préjudice. Cet arrêt illustre l’équilibre recherché entre la répression accrue des atteintes à la propriété intellectuelle et le respect des principes fondamentaux du droit pénal.
La contrefaçon, érigée en délit pénal par les articles L. 716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, constitue une infraction complexe à la frontière du droit des affaires et du droit pénal. Dans un contexte économique marqué par la mondialisation des échanges et la sophistication des réseaux de distribution, le juge français a progressivement renforcé la répression des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, tout en étant soumis à des exigences croissantes de proportionnalité et de motivation.
C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt Cour de cassation, chambre criminelle, 10 septembre 2025. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de Paris ayant condamné une société et son gérant pour contrefaçon de la célèbre semelle rouge, la Cour de cassation devait se prononcer sur trois questions fondamentales :
la validité de la marque dite de position, consistant en une couleur appliquée à une partie déterminée du produit ;
la compatibilité du cumul des sanctions douanières et pénales avec le principe constitutionnel et conventionnel de proportionnalité des peines ;
la rigueur nécessaire dans la motivation du préjudice civil en matière de contrefaçon.
Ces questions appellent une réponse équilibrée entre protection économique et garanties fondamentales. L’arrêt Louboutin manifeste à cet égard une approche double : il consolide la répression et la portée du droit des marques, tout en réaffirmant les exigences procédurales essentielles à la légitimité de la sanction.
I. La consolidation de la protection pénale du signe distinctif : validité de la marque de position et principe de proportionnalité
A. La consécration de la marque de position comme signe distinctif protégé
La Cour de cassation rejette le moyen tiré de la nullité de la marque « semelle rouge », confirmant sa validité en tant que signe distinctif au sens de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. Déposée pour désigner « la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon haut, à l’exclusion du talon », la marque remplit selon la Cour les conditions de distinctivité et de délimitation précise exigées par la loi.
La Haute juridiction s’aligne ici sur la position de la CJUE (12 juin 2018, aff. C-163/16, Louboutin c/ Van Haren Schoenen BV), selon laquelle la couleur, appliquée à un emplacement déterminé, n’est pas une « forme imposée par la nature du produit » au sens de la directive 2008/95/CE. Ainsi, la Cour française consacre la marque de position comme une catégorie autonome de signes distinctifs, aux côtés des marques verbales, figuratives ou tridimensionnelles.
Cette solution revêt une importance doctrinale majeure : elle reconnaît la possibilité d’une appropriation juridique de la couleur, dès lors qu’elle est intelligiblement circonscrite et associée à une fonction d’identification de l’origine commerciale. La semelle rouge de Louboutin, dotée d’un pouvoir évocateur et symbolique unique, répond pleinement à cette exigence : elle traduit la personnalité commerciale du produit, non sa fonction technique. Le droit des marques s’adapte ainsi à l’évolution des stratégies de communication dans le secteur du luxe, où la valeur économique repose autant sur le signe que sur le produit.
B. L’admission du cumul des sanctions douanières et pénales dans le respect du principe de proportionnalité
Les prévenus soutenaient que le cumul d’une amende douanière de 100 000 € et d’une amende pénale de 15 000 €méconnaissait le principe de proportionnalité des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 et par l’article 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le principe non bis in idem(article 50 de la même Charte).
La Cour de cassation rejette ce moyen, en rappelant que le cumul des sanctions de nature différente demeure possible à la condition que « Le montant total des amendes prononcées ne soit pas supérieur au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »
Cette règle permet la coexistence de sanctions pénales et douanières dès lors qu’elles poursuivent des finalités complémentaires :
la sanction pénale assure la répression d’une infraction portant atteinte à l’ordre public économique ;
la sanction douanière vise la protection du territoire et du marché national.
Cette conception « fonctionnelle » du principe de proportionnalité s’inscrit dans la ligne des décisions CEDH, Grande Stevens c/ Italie (4 mars 2014) et CJUE, Orsi et Baldetti (5 avr. 2017), qui admettent le cumul de procédures dès lors qu’elles forment un ensemble cohérent et proportionné. La chambre criminelle conforte ainsi la complémentarité du droit pénal et du droit douanier dans la lutte contre la contrefaçon, sans rompre l’équilibre entre répression et garanties fondamentales.
II. L’affirmation d’une rigueur procédurale accrue : motivation du préjudice civil et exigence de rationalité judiciaire
A. L’exigence de motivation dans l’évaluation du préjudice civil (art. L. 716-14 CPI)
La cassation partielle prononcée par la Cour concerne uniquement l’évaluation du préjudice. La cour d’appel avait alloué 120 000 € de dommages-intérêts aux titulaires des marques sans exposer les éléments de calcul retenus. Or, l’article L. 716-14 CPI prescrit une méthode d’évaluation en trois volets :
Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon (pertes, manque à gagner) ;
Le préjudice moral subi par le titulaire de la marque ;
Les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
En s’abstenant de motiver sa décision au regard de ces critères, la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, imposant une motivation à la fois en fait et en droit. La cassation, limitée au seul chef civil, rappelle que la réparation du préjudice de contrefaçon ne saurait être arbitraire. Le juge doit fonder son évaluation sur des données économiques objectivables, afin d’assurer la proportionnalité et la prévisibilité de la réparation.
B. La motivation, corollaire du droit au procès équitable
L’exigence de motivation revêt une portée qui dépasse le seul champ du droit des marques : elle s’inscrit dans la garantie du droit à un procès équitable, protégée par l’article 6 § 1 de la CEDH.
En exigeant une motivation explicite du préjudice, la Cour de cassation renforce la transparence du raisonnement judiciaire, condition de la légitimité de la sanction. La réparation du préjudice en matière de contrefaçon, qui présente une fonction à la fois compensatoire et dissuasive, doit reposer sur un raisonnement démonstratif permettant d’éviter les réparations purement forfaitaires. Cette approche témoigne d’un mouvement de fond du droit pénal économique : la rationalisation du contrôle juridictionnel des décisions punitives et indemnitaires.
Elle illustre l’influence croissante des standards européens de motivation et de proportionnalité, désormais indissociables d’une justice pénale conforme à l’État de droit.
Lucien MAURIN
#louboutin #marque #protection #contrefacon #marquedeposition #signedistinctif #ip #it #lawprofiler