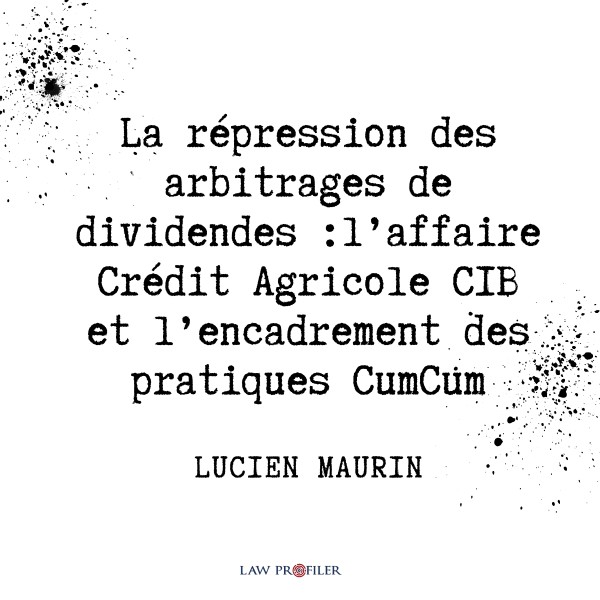
La répression des arbitrages de dividendes : l’affaire Crédit Agricole CIB et l’encadrement des pratiques CumCum par Lucien MAURIN
Le 8 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué une convention judiciaire d’intérêt public conclue entre le Parquet national financier et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB). L’enquête, ouverte en 2021 et confiée à l’Office national anti-fraude, visait des faits de blanchiment aggravé du délit de fraude fiscale aggravée liés à des arbitrages de dividendes de type CumCum. La convention fixe à 88,2 millions d’euros le montant de l’amende d’intérêt public, s’ajoutant aux 37,4 millions d’euros de droits, intérêts et pénalités déjà réglés, soit un total de 134,4 millions d’euros. Cette affaire illustre la mobilisation combinée du droit fiscal et du droit pénal pour réprimer des montages transnationaux d’élusion de la retenue à la source.
I. Le mécanisme CumCum et le droit fiscal applicable
En vertu de l’article 119 bis, 2 du Code général des impôts, les dividendes distribués par une société française à un bénéficiaire dont le bénéficiaire effectif n’est pas domicilié ou établi en France sont soumis à une retenue à la source. L’article 187 fixe le taux de cette retenue : 12,8 % pour les personnes physiques, 25 % pour les personnes morales, et 75 % lorsqu’ils sont versés dans un État ou territoire non coopératif.
Le schéma CumCum repose sur un prêt-emprunt ou une cession temporaire de titres : l’actionnaire non-résident transfère ses titres à une banque française juste avant le détachement du dividende. Le résident encaisse le dividende brut, non soumis à retenue, puis restitue les titres et reverse le dividende net à l’investisseur étranger, après avoir prélevé une commission. Le gain fiscal est obtenu par l’absence de perception de la retenue prévue par l’article 119 bis. L’investisseur étranger reçoit donc un montant équivalent à un dividende net d’impôt, tandis que l’État perd la recette liée à la retenue à la source.
II. Qualification juridique des CumCum : du droit fiscal au droit pénal
Lorsqu’une opération repose sur une véritable justification économique, elle peut être considérée comme une optimisation fiscale licite. Mais lorsqu’elle est artificielle et exclusivement motivée par un gain fiscal, elle tombe dans le champ de l’abus de droit de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Depuis 2018, l’article L. 64 A, issu de la loi de finances pour 2019, permet d’écarter également les actes dont le motif est principalement fiscal, facilitant ainsi la requalification des CumCum.
Lorsque l’intention frauduleuse est caractérisée, la qualification pénale s’impose. La fraude fiscale aggravée est prévue par l’article 1741 du CGI, qui porte la peine à 7 ans d’emprisonnement et 3 millions d’euros d’amende, pouvant aller jusqu’au double du produit fraudé en cas de bande organisée. Le blanchiment est défini par l’article 324-1 du Code pénal et peut être puni de 10 ans et 750 000 euros d’amende, montant qui peut être proportionnel aux biens blanchis. C’est sur ce terrain que le PNF a engagé les poursuites contre CACIB, considérant que la banque avait facilité la dissimulation et le recyclage du produit d’une fraude fiscale.
III. Le durcissement progressif de la législation française
Avant 2018, l’outil principal était l’article L. 64 du LPF, qui visait uniquement les actes à but exclusivement fiscal.
En 2018, la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit l’article L. 64 A, permettant d’écarter les actes à motif principalement fiscal.
En 2020, la France a transposé la directive ATAD et intégré la clause anti-abus générale, imposant que les avantages fiscaux ne puissent être obtenus via des montages non authentiques. La jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt Danish Beneficial Owners du 26 février 2019, a renforcé l’exigence de bénéficiaire effectif.
Enfin, le 16 février 2025, sont entrées en vigueur les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2024. L’article 119 bis CGI a été réécrit pour viser explicitement le bénéficiaire effectif. L’article 119 bis A a été créé pour assimiler à des revenus distribués les transferts de valeur corrélés à une distribution de dividendes. L’article 187 a été ajusté pour préciser les taux applicables et maintenir le taux de 75 % pour les États et territoires non coopératifs. Cette réforme est la première à viser directement les CumCum et les rend inopérants sur le plan fiscal.
IV. La CJIP CACIB : une réponse transactionnelle
La CJIP, prévue à l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale, permet au parquet de proposer à une personne morale mise en cause pour fraude fiscale ou blanchiment de payer une amende d’intérêt public et, le cas échéant, de mettre en place un programme de conformité. Sa validation par le juge éteint l’action publique à l’égard de la personne morale.
Dans l’affaire CACIB, l’amende d’intérêt public a été fixée à 88 247 869 euros, composée de 49 millions d’euros de part restitutive, correspondant aux avantages fiscaux indus, et de 39 millions d’euros de part afflictive, traduisant la gravité des faits. Cette sanction illustre l’articulation entre restitution à l’État et sanction pénale.
V. Enjeux économiques et institutionnels
Les pertes liées aux CumCum sont estimées à plusieurs milliards d’euros par an en France, et à plusieurs dizaines de milliards au niveau européen. Ces montages fragilisent la légitimité de l’impôt et soulèvent des enjeux de souveraineté fiscale. Pour les banques, le risque est triple : juridique, avec la possibilité de sanctions fiscales et pénales, conformité, avec l’obligation de dispositifs de vigilance fiscale et de reporting, et réputationnel, avec l’atteinte à la confiance du public et des investisseurs.
La réponse française combine désormais les textes fiscaux renforcés (articles 119 bis et 119 bis A), les outils procéduraux anti-abus (articles L. 64 et L. 64 A), les incriminations pénales aggravées (fraude et blanchiment), et l’outil transactionnel de la CJIP. Ce dispositif est complété par la coopération européenne (directive ATAD) et internationale (plan OCDE BEPS).
---
L’affaire CACIB illustre le passage d’une tolérance relative des arbitrages de dividendes à une répression organisée. Ce basculement s’explique par une série de réformes législatives, culminant avec l’entrée en vigueur le 16 février 2025 de l’article 119 bis A CGI. En validant une CJIP d’un montant de 88,2 millions d’euros, le tribunal de Paris a confirmé que ces pratiques relèvent désormais d’un arsenal répressif fiscal et pénal pleinement effectif. La combinaison entre durcissement normatif et CJIP consacre une stratégie de protection de la base fiscale et de dissuasion des acteurs financiers.Lucien MAURIN
#FraudeFiscale #CumCum #CJIP #FiscalitéInternationale #DroitPénalFinancier #Compliance #Banque #PNF #RetenueALaSource #Blanchiment #lawprofiler